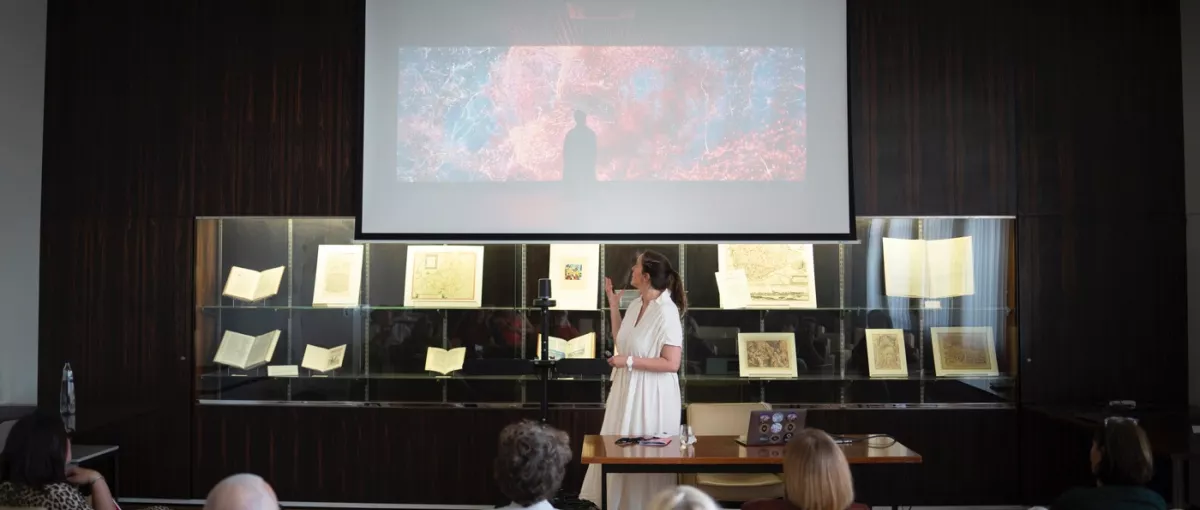
Le musée du futur – comment utiliser les innovations technologiques pour atteindre de nouveaux publics et améliorer l’expérience des visiteurs ?
Marie Du Chastel est, notamment, directrice artistique du festival KIKK, un événement international annuel dédié aux cultures numériques et créatives, organisé à Namur, qui attire quelque 28 000 visiteurs et 3 000 professionnels. La 14e édition aura lieu du 23 au 26 octobre 2025.
Marie fait autorité en matière de numérisation et d’innovation technologique dans le monde de la culture et des musées en particulier. Lors de son intervention, elle a exposé les différents volets du fonctionnement du KIKK et de Le Pavillon. Elle a expliqué pourquoi l’innovation technologique est aussi importante pour les musées et comment ces innovations permettent non seulement d’aborder des questions sociétales par le biais de l’art, mais aussi de remettre en question la technologie en tant que telle. Enfin, elle nous a montré des innovations spécifiques que les musées peuvent utiliser pour améliorer l’expérience des visiteurs et attirer un public plus large.
Dès la première partie, il est apparu que derrière les vitrines du KIKK et de Le Pavillon existe tout un écosystème de numérisation de l’art et de la culture. En plus du festival et du musée, il y a également Trakk, un fablab (laboratoire de fabrication) et un media lab, des résidences axées sur l’écologie et l’astronomie, ainsi que ikii, un espace dédié à l’innovation et la numérisation d’expériences, de performances et d’événements artistiques.
Dans la deuxième partie de sa conférence, Marie Du Chastel a expliqué pourquoi cette diversité d’activités et d’organisations est nécessaire. Comment les évolutions technologiques peuvent-elles permettre aux musées de reconquérir de nouveaux publics auprès d’autres fournisseurs numériques ?

L’objectif est de permettre au secteur culturel de suivre la dynamique numérique qui transforme pratiquement tous les domaines de la société. Une vidéo montrant une chorégraphie de mains, qui prenait des heures, voire des jours à réaliser auparavant, peut aujourd’hui être produite en quelques minutes à l’aide des bons outils et des instructions adéquates. Les idées deviennent donc primordiales. La vitesse de création s’est considérablement accrue, offrant ainsi des opportunités aux créateurs. La combinaison de la science, de la technologie et des idées créatives permet aux artistes de pousser beaucoup plus loin les expériences immersives. Et Marie Du Chastel de donner l’exemple d’une veste immersive qui permet de ressentir la sensation laissée par un tremblement de terre à Groningue, tremblement de terre causé par des décennies de forage de gaz dans la région. La technologie, la science et la numérisation nous renvoient ainsi un miroir critique.
Un exemple frappant de cette évolution est la création d’êtres humains presque parfaits à partir d’ADN collecté dans des déchets. Avis aux fumeurs : la prochaine fois, réfléchissez-y à deux fois avant de jeter votre cigarette par terre, car un jour vous pourriez en arriver à vous regarder dans les yeux lors d’une exposition consacrée au Bio Art.

Les jeunes, quant à eux, peuvent trouver leur voie vers l’art à travers la construction de mondes virtuels, comme dans les jeux vidéo. Le numérique offre en outre de nouvelles possibilités d’interaction entre l’artiste et le spectateur. Ce phénomène se retrouve aussi avec les réalités étendues (XR) et la réalité augmentée, qui confèrent subitement de nouvelles dimensions aux performances.
Cependant, il ne s’agit pas toujours de créer des expériences immersives ponctuelles. Pour les musées qui possèdent des collections permanentes, les options ne manquent pas non plus. Ce point a été abordé dans la troisième et dernière partie de la session de Marie Du Chastel. Il est par exemple possible d’utiliser son smartphone pour animer des sculptures classiques ou observer un dinosaure plus vrai que nature en se basant sur le squelette que l’on a sous les yeux.
Plus accessible, mais tout aussi impressionnante, est la valeur ajoutée du son dans les salles des musées. Les expériences sonores immersives enrichissent la perception des peintures, des sculptures ou des installations d’une manière que l’on n’aurait peut-être pas imaginée auparavant. Cela peut se faire par le biais d’installations sonores dans les salles, mais aussi grâce à des casques ou de sons diffusés par les écouteurs et smartphones des visiteurs. Les musées peuvent ainsi laisser les arts visuels vivre dans toute leur splendeur et, en même temps, en fonction du visiteur, offrir une profondeur ou une expérience supplémentaire qui va bien au-delà de la visite audioguidée classique.
Quels sont donc les plus grands défis que doivent relever les musées qui souhaitent s’engager dans cette voie ? Les contraintes financières sont un obstacle évident, mais très souvent, les conservateurs, administrateurs et gestionnaires de collections craignent de ne plus être les seuls experts. Il y a parfois trop peu de connaissances en matière de numérique au sein de nos musées, ce qui engendre la peur de faire de mauvais choix ou de développer des stratégies inappropriées.
Marie Du Chastel conseille de commencer modestement, par exemple avec des codes QR, et d’expérimenter ainsi les possibilités offertes. Et si vous êtes convaincu.e de passer à l’étape suivante, mais que vous ne disposez pas des connaissances nécessaires, n’hésitez pas à faire appel aux services d’un consultant spécialisé pour vous guider.